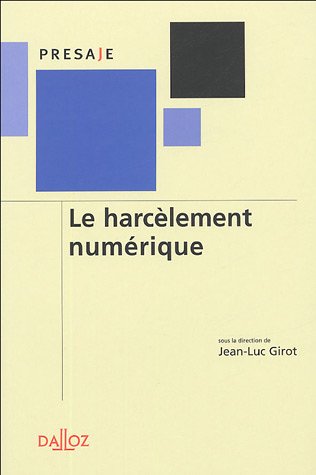
Présentation
Au début, il y avait le petit carnet du tailleur ou de la couturière qui habillait le riche marchand et son élégante épouse. Tout y figurait de l’auguste client, jusqu’aux disgrâces de la nature, voire les retards de paiements. Jamais personne n’aurait imaginé vendre ces secrets à « Félix Potin » ou aux « Dames de France ». Le client était d’abord une personne avant d’être un consommateur. Il maîtrisait son acte d’achat et méritait le respect de son intimité.
Ensuite, il y eut le catalogue du « Chasseur français » ou de « La Redoute » qui s’installa chez le client pour stimuler sa volonté d’achat, tout en respectant sa personne et sa décision éventuelle d’achat.
Aujourd’hui, il y a les « bases de données de clientèles » qui veulent que la personne soit d’abord un consommateur auquel sera appliqué un traitement incitatif, facilité par les liaisons numérisées, qui partout, à chaque instant, tenteront de lui faire perdre la maîtrise de son achat, quitte à ne pas respecter son intimité.
Au désir naturel, fonctionnel, de tout marchand de mieux connaître sa clientèle – pour la capter – s’ajoute maintenant la recherche de « traçabilité » : celle des écritures comptables, de la viande de bœuf, des comportements déviants, des images et des musiques numérisées, des armes…, le tout associé à des dispositifs de lecture permettant une centralisation croissante.
RIEN NE SE PERD, TOUT S’AFFICHE … ET SE VEND
Soyons justes : les « offreurs » de produits et de services sur le marché ont maintenant la possibilité de mieux servir leurs clients en fonction de leurs caractéristiques biologiques et sociales, de leur passé, de leurs goûts, voire de leurs manies. Ce qui veut dire meilleur emboîtement entre l’offre et la demande.
Mais qui ne voit, en regard, le prix à payer pour l’individu ? emain, les « puces » électroniques joueront les espions : en les intégrant aux produits au moment de leur fabrication, il sera possible d’en suivre le cheminement… et celui de leurs utilisateurs.
Plus inquiétante encore, la technique de reconnaissance des visages, associée aux systèmes de surveillance privés – ou dans les lieux publics – parvient aujourd’hui au stade quasi opérationnel.
Que devient, dans ces conditions, le « droit à l’oubli » ? Le fichier informatique, c’est très exactement le contraire du confessionnal : sur Internet, rien ne se perd, tout s’affiche !… et peut même être vendu pour atténuer les coûts de gestion.
Le foirail mondial du Web dispose d’un avantage supplémentaire : la vitesse, qui change totalement la donne. D’un côté, une technique galopante et difficilement prévisible ; de l’autre, une législation nécessairement plus lente à concevoir et à mettre en œuvre, du fait de la difficulté à définir la fameuse « balance des intérêts ».
ALORS, QUE FAIT LA JUSTICE ?
C’est affaire de culture. Aux Etats-Unis, le concept de « privacy » protége la personne en tant que consommateur ; en France, la protection s’adresse au citoyen en tant que personne. C’est plus qu’une nuance.
Même valse-hésitation entre deux systèmes de protection : celui de l’ « opt-out » qui repose sur un droit d’opposition accordé à l’individu pour protéger ses données, et celui de l’ « opt-in » qui suppose son consentement préalable. C’est ce dernier système qui a été adopté en droit français. Très bien. Mais l’obligation de consentement n’est pas absolue : elle peut être levée si cela est nécessaire pour – dixit la loi – « la réalisation de l’intérêt légitime poursuivi par le responsable du traitement ou par le destinataire ». L’individu ressemble de plus en plus à la chèvre de Monsieur Seguin, attaché à son écran comme à un piquet.
Intérêt « légitime » : derrière ce glissement conceptuel se profile un débat de fond sur les rapports entre le droit et l’économie. Va-t-on s’orienter vers un droit plus « utilitariste » faisant une large place au chiffre, et comment ? Qui peut être juge du marché, dont la complexité et les paradoxes échappent à l’esprit normatif des juges ?
Ce n’était déjà pas facile lorsque les révolutionnaires de 1790 ont considéré, comme les monarchistes de 1560, qu’il y avait dans le commerce une matière spéciale. Avec le « harcèlement numérique » décrit par Jean Luc Girot et son équipe, la difficulté a gravi plusieurs échelons, et, qui plus est, dans le monde entier en même temps.
L’ouvrage se veut descriptif, mais aussi – et surtout – mobilisateur. Après avoir décrit la panoplie technologique à la disposition des « inquisiteurs », il précise l’état actuel des règles du jeu, l’arsenal technique de prévention et ses limites. Surtout, il nous rappelle que la loi n’est rien sans le concours actif et incessant du citoyen.
Chasser l’obsession, cultiver la prudence : il n’est pas d’autre voie.
