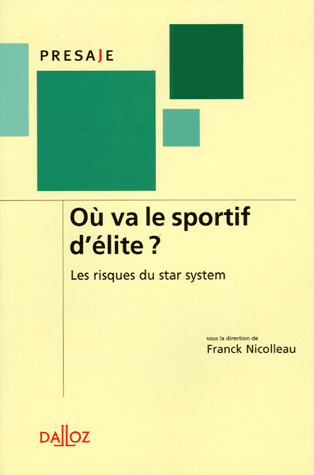
Présentation
6 juillet 2005, Londres vient de gagner un des appels d’offre les plus enviés de la planète : l’organisation des Jeux olympiques d’été de 2012. Quelle déception pour Paris !
Le sport français ne gagne plus. La France va mal.
4 août 2005, c’est désormais officiel, « il revient ». Zinédine ZIDANE réintègre l’équipe de France, en danger de ne pas se qualifier pour la phase finale de la Coupe du monde de football 2006.
17 août 2005, « la lumière est revenue ». L’Equipe de France emmenée par son capitaine a remporté le match amical disputé contre la Côte d’Ivoire.
Le football français retrouve la victoire. La France va mieux.
Sûrement le plus grand phénomène social qui s’est révélé au cours du XXe siècle, le sport, en l’espace d’un siècle, a en effet réussi à se développer sur la planète entière et à atteindre toutes les couches sociales, sans exception. Il s’est muté en un véritable fait de civilisation. Avec son milliard de pratiquants, dont 14 millions de licenciés en France, le sport est partout et se décline sous toutes les formes. Il est à la fois spectacle, produit de consommation, moyen de publicité, journal, magazine, loisir, etc.
Il en résulte que le sport intéresse toutes les disciplines. Beaucoup d’ouvrages ont naturellement été publiés sur le sujet. Paradoxalement, il n’en existe que très peu consacrés au sportif d’élite lui-même et à son avenir.
Or, le sportif d’élite s’est radicalement transformé par rapport à ce qu’il était il y a à peine cinquante ans. Son image n’a jamais été autant utilisée par les entreprises, les médias, les publicitaires ou les politiques. S’il en est ainsi, c’est que le sportif d’élite représente l’acteur principal de ce phénomène de société, dont il en est tout simplement la vitrine. A ce rythme là, comment présager son avenir ? A quoi ressemblera le sportif d’élite du XXIème siècle ?
Est-ce que le conte prospectif, qui introduit l’ouvrage et a été imaginé par Michel Rouger, président de l’institut PRESAJE, deviendra une réalité bien banale ? Comment le sociologue, l’économiste, le scientifique, le médecin et le juriste conçoivent-ils l’avenir du sportif d’élite ?
L’analyse porte essentiellement sur l’élément phare : le sportif dit « d’élite », qui évolue principalement au sein du sport spectacle. Celui-ci ne réunit qu’une petite partie de l’ensemble des sportifs pratiquant la haute compétition. La masse des sportifs d’élite reste en effet inconnue du grand public tout simplement parce que les médias – au premier rang desquels la télévision – ne s’intéressent que très peu au sport qu’ils pratiquent. Qu’on le déplore ou qu’on s’en félicite, on ne saurait nier que l’évolution du sport d’élite est essentiellement conduite par cette minorité de sportifs.
Cet ouvrage se donne pour objectif d’apprécier dans quelle mesure on peut concilier la protection humaniste du sportif d’élite – homme ou femme – avec la compétitionspectacle mondialisée, minutieusement productivisée, rentabilisée et financiarisée, laquelle le conduit à se comporter, consciemment ou inconsciemment, comme un producteur de performances, de records et de victoires absorbés par un marché instantané de plus d’un milliard de consommateurs. Ces deux axes de réflexion sont intimement liés en ce que nous nous engageons ou dérivons de plus en plus dans une société de la performance et de la rentabilité.
La première partie de l’ouvrage est ainsi consacrée au sportif d’élite de demain comme modèle de société, tandis que la seconde s’intéresse à celui-ci comme modèle de performances. D’où nos réflexions finales – et nos propositions – sur la régulation de demain… et d’après-demain.
Face à ces bouleversements socio-économiques, où va le sportif d’élite ? Que faire ? Mieux réguler ? Comment ? Jusqu’où ?
Ne pourrait-on concevoir une instance internationale qui établirait des normes ? Faudrait-il mettre en place des « commissaires aux performances » ? Devrait-on instituer une « autorité des marchés du sport », comme il en existe pour les marchés financiers ?
L’ennui, c’est que la définition des normes et de leur surveillance, comme les décisions de sanction, ne peuvent être efficaces que si l’on se place au niveau international. Ce qui suppose une volonté commune des Etats et des Fédérations. Ce n’est pas gagné d’avance.
Voilà bien un sujet typiquement « présajien » !
